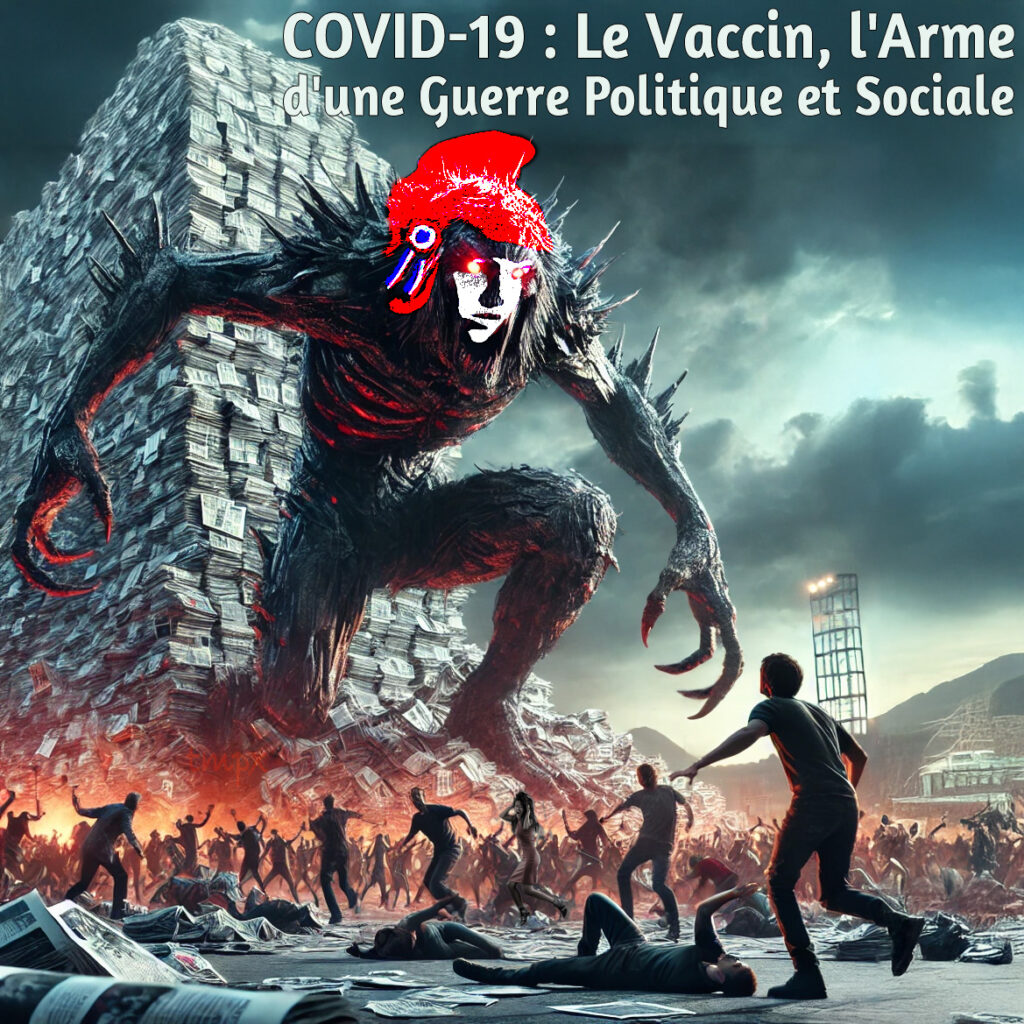
Source/Inspriration : Institut Paul Ehrlich (PEI)
Introduction
Depuis que Monsieur Emmanuel Macron a déclaré solennellement être en « guerre » contre la COVID-19 le 16 mars 2020, le débat critique autour de cette gestion reste étouffé en France. Les décisions stratégiques, les politiques publiques, et notamment les contrats d’achat de vaccins, sont enfermés dans un secret défense qui empêche toute transparence. Dans ce contexte, les médias, qui devraient être un contre-pouvoir, ont servi de bras armé à cette guerre de l’information. Ils continuent à disqualifier systématiquement toute critique des politiques vaccinales ou des effets secondaires, étouffant le débat public. Par conséquent, pour obtenir une vision plus nuancée et réaliste, il est souvent nécessaire de se référer à des études et des synthèses provenant de pays voisins, comme l’Allemagne et l’Institut Paul Ehrlich (PEI).
Cependant, une affirmation récurrente dans les discours officiels et médiatiques sur les campagnes vaccinales – que la vaccination aurait permis de limiter les formes graves de la maladie dans certaines populations – est fausse. La diminution des formes graves observée fin 2021 s’explique principalement par l’émergence de nouveaux variants plus contagieux mais bien moins nocifs que le virus original. Cette réalité disqualifie totalement les mesures autoritaires telles que la vaccination obligatoire des personnels de santé, des pompiers, des militaires, ainsi que les discriminations abjectes à l’égard des non-vaccinés.
1. Contexte de la vaccination COVID-19
La campagne de vaccination COVID-19 a été menée dans un contexte d’urgence sanitaire mondiale. Les vaccins ont été autorisés via des procédures accélérées, sans les années de suivi traditionnellement associées aux nouveaux produits biomédicaux. Cette situation exceptionnelle a soulevé des questions sur la capacité des régulateurs, comme le PEI, à évaluer pleinement les risques et les bénéfices, surtout dans un climat où toute critique publique était largement décrédibilisée.
2. Problèmes majeurs dans la surveillance et la transparence
- Manque de données robustes sur les effets à long terme :
- Les essais cliniques des vaccins COVID-19 n’ont pas bénéficié de la durée habituelle d’observation, ce qui a laissé des lacunes dans la compréhension des effets secondaires rares ou retardés.
- Les études post-commercialisation, censées combler ces lacunes, ont été insuffisantes ou faiblement médiatisées.
- Dépendance au signalement spontané :
- Le PEI se repose sur un système de déclaration spontanée pour détecter les effets secondaires. Or, ce système est notoirement sujet à une sous-déclaration importante, car de nombreux patients et médecins hésitent à signaler des événements indésirables, soit par manque de connaissance, soit par peur de stigmatisation.
- L’institution elle-même admet que les doublons et les erreurs dans les rapports faussent les statistiques, rendant difficile une estimation précise de la fréquence réelle des effets secondaires graves.
- Déni de certains signaux d’alerte :
- Les myocardites/péricardites associées aux vaccins à ARNm (Pfizer/BioNTech et Moderna) ont été classées comme “très rares” (<1/10 000), mais des données indépendantes suggèrent une incidence plus élevée, notamment chez les jeunes hommes.
- Le “syndrome post-vaccinal” (post-vac), comprenant des symptômes similaires au Long COVID, a été largement ignoré ou minimisé, malgré des rapports individuels croissants de fatigue chronique, troubles neurologiques et syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS).
- Absence de reconnaissance officielle des dommages :
- L’Institut Paul Ehrlich se décharge de la responsabilité concernant les demandes d’indemnisation pour les dommages vaccinaux, ce qui laisse les victimes face à une bureaucratie complexe et souvent sans soutien clair.
- L’absence de données accessibles au public sur les cas reconnus de dommages dus à la vaccination renforce un sentiment d’opacité.
3. Rôle des médias et marginalisation des critiques
Pendant la campagne de vaccination, les médias grand public ont joué un rôle actif dans la promotion des vaccins, souvent au détriment de toute discussion critique.
- Silence sur les effets secondaires graves :
- Les cas d’effets secondaires graves ou de décès après vaccination ont été minimisés ou présentés comme “coïncidences” dans les médias, alors même que certains de ces cas faisaient l’objet d’investigations par des agences comme le PEI.
- Les récits de personnes souffrant de complications graves ont été peu relayés, et ceux qui partageaient ces expériences sur les réseaux sociaux étaient souvent accusés de désinformation.
- Décrédibilisation systématique des voix critiques :
- Des chercheurs et médecins exprimant des inquiétudes sur les vaccins COVID-19 ont été qualifiés de “complotistes” ou de “désinformateurs” sans que leurs arguments soient sérieusement examinés.
- Les publications scientifiques explorant les risques des vaccins ont souvent fait face à des rétractations rapides ou à des pressions politiques et économiques.
- Absence de débat équilibré :
- Le discours dominant était axé sur l’efficacité des vaccins pour prévenir les formes graves et la mortalité, mais peu d’attention a été accordée à leur incapacité à prévenir efficacement les contaminations, ce qui a remis en question l’efficacité des passeports vaccinaux.
4. Conséquences et implications sociétales
- Perte de confiance dans les institutions :
- Le manque de transparence et la perception d’un discours unilatéral ont alimenté la méfiance envers les autorités sanitaires, les institutions scientifiques et les médias.
- De nombreuses personnes ayant subi des effets secondaires graves se sont senties abandonnées par le système de santé et les régulateurs.
- Stigmatisation des non-vaccinés :
- La pression sociale et les politiques discriminatoires (passe sanitaire, exclusion professionnelle) ont créé une fracture sociétale importante, amplifiée par un manque de reconnaissance des risques individuels associés à la vaccination.
- Les “enmerdements” promis par Emmanuel Macron envers les non-vaccinés, accompagnés d’interdictions d’accès aux lieux publics (cinémas, restaurants, marchés de Noël), ont entraîné une exclusion sociale inédite. Les discriminations envers les enfants non-vaccinés, interdits de clubs de sport et d’activités collectives, figurent parmi les mesures les plus injustifiables.
- Sous-évaluation des coûts humains :
- Les effets secondaires graves, bien que minoritaires, représentent des drames individuels sous-estimés. Le coût émotionnel, psychologique et financier pour les personnes concernées reste absent du débat public.
5. Recommandations pour un débat plus équilibré
- Transparence totale :
- Publier des données détaillées sur les dommages reconnus, y compris les indemnisations versées.
- Fournir un suivi public clair des cas graves et des études à long terme sur les effets secondaires.
- Encourager un débat scientifique libre :
- Mettre fin à la stigmatisation des chercheurs et médecins qui expriment des doutes ou posent des questions légitimes.
- Soutenir des études indépendantes sur les effets secondaires et les bénéfices des vaccins.
- Adapter les politiques de vaccination :
- Évaluer de manière critique la pertinence des campagnes universelles dans un contexte de variants moins virulents.
- Encourager des débats ouverts entre scientifiques favorables et opposés aux politiques vaccinales pour garantir une prise de décision éclairée et plurielle.
- Mettre en place une surveillance en temps réel des effets des vaccinations, afin de réagir rapidement à tout signal de risque.
- Instituer une réévaluation scientifique permanente des décisions prises, à la lumière des nouvelles données et études.
Synthèse
La gestion de la campagne vaccinale COVID-19, loin d’être le succès affirmé par les discours officiels, repose sur des bases fragiles. La diminution des formes graves était principalement due à l’émergence de variants moins nocifs, et non à l’efficacité vaccinale. Cette réalité discrédite les politiques autoritaires de vaccination obligatoire en France, notamment pour les personnels de santé, les pompiers, et les militaires, ainsi que les mesures discriminatoires et coercitives à l’encontre des non-vaccinés. Pour restaurer la confiance publique, il est impératif de reconnaître les erreurs passées, de cesser les stigmatisations, et de promouvoir un débat scientifique authentique et transparent.
L’Institut Paul Ehrlich (PEI) : Régulation et recherche biomédicale en Allemagne
L’Institut Paul Ehrlich (PEI) est une autorité fédérale allemande, sous tutelle du Ministère de la Santé, spécialisée dans l’évaluation des vaccins et biomédicaments. Il joue un rôle central dans la régulation, la recherche et la surveillance de ces produits.
Rôles principaux
- Évaluation scientifique : Analyse de l’efficacité, de la sécurité et de la qualité des vaccins avant leur mise sur le marché.
- Surveillance : Suivi des effets secondaires après commercialisation.
- Recherche : Études sur les mécanismes des vaccins et traitements biologiques.
- Autorisation clinique : Validation des essais cliniques pour les produits biologiques.
Financement
Principalement financé par des fonds publics, le PEI perçoit aussi des revenus issus de frais de service (examens d’autorisation) et de subventions de recherche, tout en respectant des règles strictes de transparence.
Critiques et crédibilité
Respecté pour sa rigueur scientifique, le PEI fait face à des critiques sur sa rapidité d’approbation ou ses liens perçus avec l’industrie, notamment durant la pandémie de COVID-19. Il publie régulièrement des données pour garantir la transparence.
En bref
Le PEI est un pilier de la santé publique Allemande, conciliant régulation, innovation et surveillance pour assurer la sécurité des vaccins et biomédicaments.

