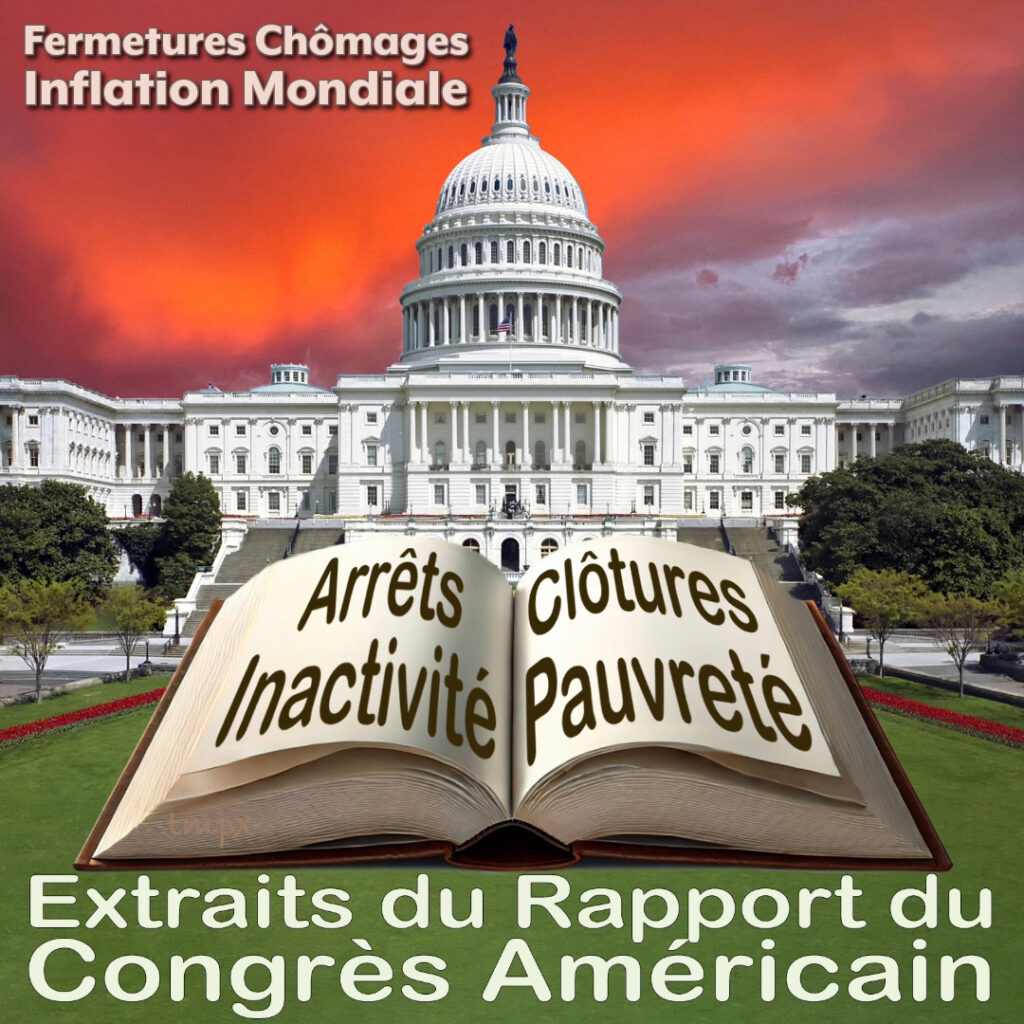
Synthèse des Pages de 376 à 410 sur 520 du Rapport du Congrès Américain:
Dans cet Article:
- Une pandémie de décisions aux Etats-Unis
- Exactement comme en Amérique, une pandémie de décisions en France
- PDF : Traduction Reaction19, du Rapport du Congrès Américain de décembre 2024
- PDF : Original, du Rapport du Congrès Américain de décembre 2024
Une pandémie de décisions aux Etats-Unis
Quand Big Pharma, les cabinets de conseil comme McKinsey et les gouvernements ont privilégié les profits au détriment des populations
Introduction : Une gestion politique transformant une crise sanitaire en désastre mondial
La pandémie de COVID-19 a révélé des failles profondes dans la gouvernance mondiale. Sous l’influence d’acteurs comme Big Pharma et des cabinets de conseil tels que McKinsey, les gouvernements ont pris des décisions souvent basées sur des théories non scientifiques et des projections biaisées. Ces choix, censés anticiper et contenir la crise, ont conduit à une catastrophe économique et sociale sans précédent. Si le Rapport du Congrès Américain de décembre 2024 analyse les conséquences de la pandémie sur les entreprises, les travailleurs et les collectivités, il reste silencieux sur le rôle déterminant joué par ces cabinets dans la définition des politiques publiques.
I. Les entreprises américaines : Fermetures massives et marginalisation des PME
Les fermetures d’entreprises : Un choc économique auto-infligé
Entre mars et août 2020, 163 735 entreprises américaines avaient fermé leurs portes, dont 60 % de manière permanente. Parmi elles, les PME ont été les plus durement touchées, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du commerce de détail. Par exemple, à la fin de l’année 2020, 17 % des restaurants avaient fermé définitivement, selon un rapport de la National Restaurant Association. Ces fermetures sont attribuables à des décisions politiques uniformes, imposant des restrictions sanitaires strictes et prolongées, sans tenir compte des spécificités locales ou sectorielles.
Les décisions, largement inspirées par des recommandations de cabinets de conseil comme McKinsey, ont privilégié les grandes entreprises capables de s’adapter rapidement. Les PME, qui manquent souvent de ressources financières et technologiques, ont été laissées pour compte. Dans les zones rurales et à faibles revenus, ces fermetures ont aggravé des disparités socio-économiques préexistantes, laissant des régions entières sans tissu économique viable.
Des aides biaisées et mal conçues
Le Paycheck Protection Program (PPP), introduit en avril 2020, devait soutenir les petites entreprises. Cependant, le rapport souligne que seules les entreprises ayant les moyens administratifs et financiers de naviguer dans le processus complexe ont pu bénéficier de ces fonds. Pendant ce temps, de grandes entreprises et chaînes nationales ont capté une part disproportionnée de l’aide. En conséquence, des milliers de PME ont été contraintes à la faillite.
Ces fermetures massives, évitables dans de nombreux cas, témoignent de politiques conçues pour protéger les grandes structures. L’influence des cabinets de conseil, bien qu’omise dans le rapport, a orienté des décisions favorisant les acteurs dominants, au détriment des entreprises locales et des économies régionales.
II. Les travailleurs : Victimes des inégalités structurelles exacerbées
Un chômage sans précédent : Les bas salaires sacrifiés
En avril 2020, le taux de chômage américain a atteint 14,8 %, un niveau record depuis la Grande Dépression. Les secteurs à bas salaires, tels que l’hôtellerie, les loisirs et le commerce de détail, ont été les plus touchés, avec des pertes d’emploi dépassant 60 %. À l’inverse, les professionnels des secteurs bien rémunérés (technologie, finance) ont pu basculer vers le télétravail et maintenir leur emploi.
Les mesures de confinement, imposées sous les recommandations du Dr Anthony Fauci, alors directeur du NIAID, et soutenues par des cabinets comme McKinsey, ont été appliquées uniformément, sans considération pour les impacts disproportionnés sur les travailleurs précaires. Ces choix ont accentué les inégalités sociales, plaçant des millions de familles dans une situation de précarité prolongée.
Un système d’aide mal ciblé
Le Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC), lancé en mars 2020, versait 600 $ par semaine aux chômeurs. Bien qu’essentiel pour éviter une crise humanitaire immédiate, ce programme a également dissuadé certains travailleurs de reprendre leur emploi, contribuant aux pénuries de main-d’œuvre dans des secteurs clés.
L’automatisation : Une accélération inégale
Les confinements et la distanciation sociale ont accéléré l’adoption de l’automatisation, privant de nombreux travailleurs précaires de leurs moyens de subsistance. En juin 2024, les taux d’emploi dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie restaient 20 % en deçà des niveaux pré-pandémiques, selon le Bureau of Labor Statistics.
Les politiques gouvernementales, souvent influencées par des cabinets de conseil et orientées vers des solutions macroéconomiques, ont ignoré les réalités des travailleurs précaires. L’absence de soutien ciblé a exacerbé les inégalités et marginalisé des millions de travailleurs.
III. La Réserve fédérale : Une stabilisation monétaire au profit des grandes entreprises
Des interventions massives et leurs conséquences
Sous la direction de Jerome Powell, la Réserve fédérale a rapidement abaissé les taux d’intérêt à zéro en mars 2020 et lancé un programme d’assouplissement quantitatif (QE) d’une ampleur inédite. En quelques mois, elle avait injecté plus de 700 milliards de dollars dans les marchés financiers, stabilisant les grandes entreprises et évitant un effondrement des indices boursiers.
Cependant, ces mesures ont favorisé les grands acteurs économiques, au détriment des PME et des collectivités locales. En outre, l’expansion monétaire massive a alimenté une inflation record dès la fin de 2021, atteignant 7 % en décembre selon le Bureau of Labor Statistics.
Un rôle élargi et des précédents risqués
En avril 2020, la Réserve fédérale a introduit des programmes comme le Main Street Lending Program et le Municipal Liquidity Facility, habituellement du ressort du Trésor américain. Ces initiatives ont brouillé les frontières entre politique monétaire et budgétaire, créant une dépendance dangereuse des marchés aux soutiens publics.
Si les actions de la Réserve fédérale ont stabilisé l’économie à court terme, elles ont également exacerbé les inégalités structurelles et créé un environnement économique instable, marqué par l’inflation et la dépendance aux interventions publiques.
Une gestion influencée par des intérêts privés
Le Rapport du Congrès Américain de décembre 2024 analyse les conséquences des politiques publiques sur les entreprises, les travailleurs et l’économie globale. Cependant, il omet d’examiner l’influence des cabinets de conseil comme McKinsey et des intérêts de Big Pharma, qui ont joué un rôle clé dans l’élaboration des décisions. Ces omissions reflètent un problème systémique : des décisions politiques orientées par des intérêts privés et des projections macroéconomiques, au détriment des besoins réels des populations et des économies locales.
Pour éviter qu’une telle gestion ne se reproduise, une transparence accrue et une implication interdisciplinaire dans la prise de décision sont indispensables. Les leçons de cette crise doivent guider une réforme des structures de gouvernance, pour privilégier les populations plutôt que les profits.
Une pandémie de décisions en France
Comment Big Pharma, McKinsey et des choix politiques discutables ont plongé le pays dans une crise économique et sociale
La France face à une double crise – sanitaire et politique
La pandémie de COVID-19 a été gérée en France avec une centralisation excessive, des décisions souvent dictées par des recommandations de cabinets de conseil comme McKinsey et une influence marquée des intérêts pharmaceutiques. La stratégie française, axée sur des confinements stricts, la fermeture généralisée des entreprises et une campagne vaccinale controversée, a provoqué des dégâts économiques et sociaux considérables. Bien que des aides aient été mises en place, leur inefficacité et leur ciblage biaisé ont amplifié les inégalités et freiné la reprise.
Cet article critique analyse la gestion française à travers trois axes : l’impact sur les entreprises, les travailleurs, et les politiques économiques et sanitaires, tout en mettant en lumière les acteurs clés et les chiffres marquants.
I. Les entreprises françaises : Victimes d’une gestion bureaucratique et de fermetures massives
Les fermetures : Une destruction économique à grande échelle
En France, les trois confinements imposés entre mars 2020 et mai 2021 ont forcé des milliers d’entreprises à fermer leurs portes. Selon l’INSEE, plus de 175 000 entreprises ont cessé leur activité en 2020, un record historique. Les secteurs de la restauration, du commerce de détail et de l’hôtellerie ont été les plus touchés, avec une baisse d’activité de 50 % en moyenne. Par exemple, le chiffre d’affaires de l’hôtellerie a chuté de 60 % en 2020, selon l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH).
Ces décisions ont été prises sous l’impulsion d’Emmanuel Macron, appuyé par son ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, et guidées par des cabinets de conseil comme McKinsey, dont le rôle dans la gestion de la crise a été largement documenté. Ces cabinets, en facturant des dizaines de millions d’euros, ont élaboré des stratégies standardisées favorisant les grandes entreprises, tout en négligeant les PME et les TPE qui constituent 95 % du tissu économique français.
Des aides inefficaces et inaccessibles
Le gouvernement a instauré des dispositifs tels que le fonds de solidarité et le prêt garanti par l’État (PGE), qui ont représenté plus de 140 milliards d’euros d’engagements en 2020. Cependant, selon une étude de la Banque de France, 35 % des petites entreprises n’ont pas eu accès à ces aides en raison de critères d’éligibilité complexes ou d’un manque de connaissances administratives. En parallèle, des multinationales comme Amazon ont vu leur chiffre d’affaires exploser (+44 % en 2020) grâce à la fermeture des commerces physiques, créant une concurrence déloyale et amplifiant les disparités.
La gestion française, influencée par des recommandations centralisées et des stratégies mal adaptées, a sacrifié des milliers de petites entreprises pour privilégier des solutions favorables aux grandes structures, aggravant le déséquilibre économique.
II. Les travailleurs : Entre chômage massif et marginalisation durable
Une explosion du chômage et une précarisation accrue
Entre mars et mai 2020, la France a enregistré une hausse brutale du chômage, avec plus de 900 000 demandeurs d’emploi supplémentaires, selon Pôle emploi. Les secteurs à bas salaires, comme la restauration et le commerce, ont été les plus impactés, tandis que les travailleurs précaires ont été exclus des dispositifs d’aides comme le chômage partiel.
Les décisions politiques, sous l’égide de Jean Castex, Premier ministre à l’époque, ont été prises sans consultation des syndicats ou des acteurs de terrain. Les mesures comme le télétravail obligatoire ont bénéficié aux salariés des grandes entreprises, tandis que les travailleurs des secteurs essentiels, souvent mal rémunérés, ont été exposés au virus sans compensation adéquate.
L’impact à long terme : Chômage structurel et automatisation
Les confinements successifs ont accéléré l’automatisation et la numérisation des emplois, rendant de nombreux postes obsolètes. Selon une étude de l’Institut Montaigne, 25 % des emplois à bas salaires sont menacés par l’automatisation d’ici 2030. En parallèle, le télétravail, adopté par 40 % des cadres, a renforcé les inégalités entre les travailleurs qualifiés et les moins qualifiés, souvent exclus de ces nouvelles dynamiques.
Les décisions du gouvernement ont amplifié les inégalités sur le marché du travail, abandonnant les travailleurs précaires à leur sort tout en favorisant les grandes entreprises et les professions bien rémunérées.
III. Politiques économiques et sanitaires : Une stratégie au service de Big Pharma
Une campagne vaccinale marquée par les intérêts privés
La gestion de la vaccination en France, pilotée par des cabinets comme McKinsey, a coûté plus de 12 millions d’euros en frais de conseil, selon un rapport sénatorial publié en mars 2022. Les vaccins produits par Pfizer et Moderna ont été largement privilégiés, au détriment de solutions moins coûteuses comme les vaccins classiques (ex. Valneva).
Emmanuel Macron et son ministre de la Santé, Olivier Véran, ont multiplié les déclarations pour justifier des mesures coercitives, comme le pass sanitaire instauré en juillet 2021, tout en ignorant les critiques sur les contrats opaques passés avec les laboratoires pharmaceutiques. Ces choix, dictés par des intérêts privés, ont alimenté une défiance croissante dans la population, avec près de 30 % de Français refusant la vaccination en 2021 selon Santé Publique France.
Une gestion budgétaire inflationniste
Les dépenses publiques liées à la crise ont dépassé 200 milliards d’euros en 2020, selon la Cour des Comptes. Si ces dépenses ont permis de limiter les effets immédiats de la crise, elles ont également contribué à une inflation record, atteignant 6,2 % en juin 2022. En parallèle, la dette publique française a explosé pour atteindre 115 % du PIB, posant des questions sur la soutenabilité à long terme de cette politique.
La gestion économique et sanitaire française a été dominée par des choix favorisant Big Pharma et les cabinets de conseil, au détriment de la transparence et de l’efficacité. Les décisions budgétaires inflationnistes ont alourdi la dette sans garantir une reprise équitable.
Une crise aggravée par des choix politiques guidés par des intérêts privés
La gestion française de la pandémie de COVID-19 illustre les dérives d’une gouvernance influencée par des acteurs externes comme McKinsey et Big Pharma. Les politiques publiques, centrées sur des solutions macroéconomiques et des recommandations bureaucratiques, ont sacrifié les petites entreprises, marginalisé les travailleurs précaires et favorisé les intérêts des grandes structures.
Pour éviter qu’un tel désastre ne se reproduise, il est urgent de réformer la gouvernance en intégrant davantage de transparence, de consultation des acteurs de terrain et d’équité dans les décisions. La France doit tirer les leçons de cette crise pour rétablir la confiance et protéger l’ensemble de sa population, et non seulement les intérêts de quelques-uns.

